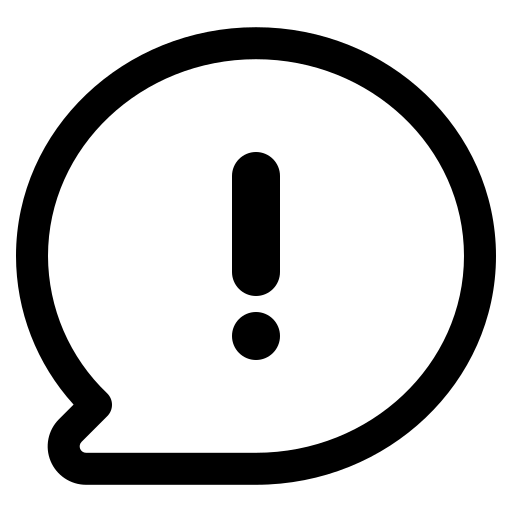Notre monde est rempli d’ironies parfois bien amères. C’est le cas des étés étudiants: après avoir travaillé fort à l’école toute l’année durant, on se retrouve en vacances… à travailler à temps plein. Pour le repos, on repassera. Le comble, c’est qu’on y est contraint.e par la nécessité de payer les factures à venir pendant l’année scolaire, puisque les étudiant.es n’ont aucun revenu lié à leur activité principale: les études. Tout travail mérite pourtant salaire, non? On a malheureusement fini, même dans le mouvement étudiant, par ne plus questionner cette absurdité, à ne plus nous poser cette question évidente: pourquoi le travail étudiant n’est-il pas rémunéré au même titre que les autres emplois?
« Ben voyons, les études c’est pas un travail! », nous répondront certaines personnes. Or, vous pouvez consulter n’importe quel dictionnaire, la définition est claire: le travail, c’est ni plus ni moins que « l’activité de [l’être humain] appliquée à la production, à la création, à l’entretien de quelque chose. » Les études correspondent donc à l’activité d’apprentissage et d’entraînement requise pour acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine quelconque; c’est un moyen que l’on utilise pour se développer en tant qu’individu, mais aussi un mécanisme aujourd’hui incontournable pour devenir des travailleurs et travailleuses capables d’agir consciencieusement dans un emploi et dans la vie en général. Les gouvernements ont compris, il y a déjà un bon moment, qu’il n’y a pas de plus importante production économique et sociale que celle des personnes, elles-mêmes à la source de toute production et de toute valeur. Cela justifie qu’un des secteurs où ils dépensent le plus (avec la santé, servant en quelque sorte à l’entretien physique des personnes) demeure celui de l’éducation.
Oui, l’activité étudiante est un travail… mais un travail non salarié. Pourquoi certaines activités productives sont suffisamment reconnues pour mériter un salaire, et d’autres non? D’une part, nous vivons dans une société capitaliste structurée autour de la production de marchandises permettant aux personnes qui détiennent les moyens de production d’engranger des profits. D’autre part, la société moderne est divisée en deux sphères d’activité, le public et le privé. Ce qui se déroule dans la vie privée, à l’abri des regards, ne peut être valorisé aussi commodément que la production officielle, d’autant plus en ce qui concerne le travail prenant la personne elle-même comme matériau, comme c’est le cas avec les études. Bref, le travail étudiant est invisibilisé; normal dans ces circonstances que même les personnes qui l’accomplissent en viennent à douter de la valeur de leur propre activité et trop souvent, par conséquent, de leur propre valeur. À tort, bien entendu.
On en vient à prendre pour acquis et à considérer comme rationnels la misère persistante des étudiant.es et le fait qu’ils et elles occupent pour la plupart deux emplois: leurs études et un emploi à temps partiel. Certain.es s’en consolent en se disant qu’au moins, ces personnes peuvent compter sur une assistance spécifique de l’État: l’aide financière aux études (AFE). Résumons la démarche: pour obtenir de l’AFE, l’étudiant.e doit faire parvenir au gouvernement certaines informations afin de déterminer quelle assistance peut lui être octroyée, à la suite de quoi le gouvernement lui accorde une garantie de prêt de quelques milliers de dollars (en moyenne) dans une banque quelconque et, pour beaucoup d’entre eux et elles, une bourse de quelques milliers de dollars supplémentaires¹.
La logique qui sous-tendait à ses débuts, dans les années 1940, le programme québécois d’appui financier aux étudiant.es est la même qu’aujourd’hui: les étudiant.es sont des jeunes gens aux revenus modestes dont nous souhaitons à la fois la réussite scolaire et un passage à la vie adulte à moindre coût, via de modestes bourses et des dettes à rembourser après leurs études. Or, non seulement l’État québécois est-il encore aussi paternaliste avec les étudiant.es qu’il y a maintenant trois quarts de siècle, mais c’est un père qui n’éprouve aucun remords à maltraiter les personnes supposément à sa charge². Car vraiment, les sommes versées aux étudiant.es sont dérisoires: un peu plus de 6500$ en moyenne lors de l’année scolaire 2013-2014, soit moins de 18$ par jour (dont la moitié en prêt et donc en dette par la suite). Et malgré l’augmentation sans relâche du coût de la vie, les montants de base utilisés pour le calcul des dépenses admises stagnent jusqu’à en devenir ridicules. Par exemple, pour un.e étudiant.e qui n’habite pas chez ses parents, le maximum des frais de subsistance (logement, nourriture, transport en commun et dépenses personnelles) admis par l’État sera en 2016-2017 de 837$ par mois, soit seulement 27$ par jour³… un maximum d’ailleurs rarement octroyé. L’AFE prend aussi en compte d’autres dépenses directement reliées aux études mais, encore là, à partir de valeurs de base irréalistes. Il est clair et net que le programme québécois de prêts et bourses n’aide pas suffisamment les étudiant.es pour être considéré comme l’équivalent d’un salaire étudiant, loin de là.
Les politicien.nes et bureaucrates sont conscient.es de cette carence, mais ont une excuse commode pour la justifier: si l’étudiant.e dispose aussi de revenus d’emploi et de contributions familiales, le montant de l’AFE suffira à ce que ses besoins soient comblés. En plus de devoir plus souvent qu’autrement travailler durant ses études et de ne pas pouvoir jouir de vacances d’été, tout en s’endettant lourdement, on attend encore davantage de l’étudiant.e: ou bien qu’il ou elle soit parent ou se marie durant ses études⁴, ou bien qu’il ou elle soit en assez bons termes avec ses parents et que ceux-ci soient suffisamment en moyens pour pouvoir payer une partie de ses études. Ainsi, non seulement les étudiant.es sont-ils et elles traité.es en véritables enfants, mais on les pousse par d’importants incitatifs fiscaux à être redevables envers leurs parents et à ultimement fonder une famille si les études les intéressent. La boucle du paternalisme est bouclée! Au lieu de devoir supporter tant de contraintes pour recevoir si peu d’argent en retour, pas étonnant que plus de deux étudiant.es sur trois en droit de demander de l’argent à l’AFE choisissent, année après année, de se débrouiller tant bien que mal sans celle-ci. On n’a qu’à penser, par exemple, aux personnes des communautés LGBTQIA+⁵ pour qui les relations familiales sont souvent difficiles, du fait de la non-acceptation de leurs rapports de genre non traditionnels, et pour qui le critère de contribution parentale est donc particulièrement cruel.
Il y a réellement quelque chose d’obscène à s’acharner à infantiliser des adultes de la sorte. Bien sûr, il peut paraître raisonnable de chercher à régler le problème de la pauvreté étudiante grâce à différentes réformes du modèle actuel, telles que convertir tous les prêts en bourses, en accorder davantage et éliminer les conditions d’admission nuisibles à l’aide financière et aux études elles-mêmes, incluant la contribution parentale mais aussi les frais de scolarité. C’est cette perspective qu’a adoptée la gauche étudiante québécoise au cours des dernières décennies. Après tout, il est juste de prétendre que l’endettement étudiant est un véritable boulet financier qui en dissuade plus d’un.e à entreprendre des études et dont les travailleurs et travailleuses post-études n’ont vraiment pas besoin, eux et elles qui ont déjà bien souvent du fil à retordre pour se trouver un emploi dans leur domaine. Ces mesures auraient aussi le mérite de nous distancier de la nécessité de bonne entente familiale, qui a peu à voir avec les moeurs d’aujourd’hui. Or, des enfants mieux traités restent des enfants, et le travail reste le travail: les étudiant.es en stage ou ceux et celles faisant de la recherche effectuent clairement du travail qui serait forcément rémunéré s’ils ou elles l’accomplissaient en tant qu’employé.es. À des degrés variables, la totalité des étudiant.es réalisent un travail individuellement et socialement utile. Ils et elles font bien plus qu’être des bénéficiaires de services publics: ils et elles acceptent volontairement de travailler sans salaire sous prétexte d’une maigre pitance permettant de vivre pauvrement; c’est la définition même d’une mentalité d’esclave. On vaut bien plus que ça et il est temps d’agir en conséquence⁶.
De toute façon, l’AFE, telle qu’on la connaît, disparaîtra peut-être bientôt au Québec pour des raisons tout autres: le revenu minimum garanti (RMG) est présentement à l’étude au sein du gouvernement provincial et, chez les étudiant.es, il pourrait en venir à remplacer l’AFE. L’idée du RMG connaît présentement un engouement renouvelé aux quatre coins du monde et elle est plutôt simple. Il s’agit de remplacer une grande partie ou même l’ensemble des programmes gouvernementaux de soutien au revenu – par exemple l’AFE, l’aide sociale, l’assurance-emploi, les congés parentaux et les pensions de vieillesse – par une certaine forme de revenu octroyé par l’État à plusieurs groupes de personnes, voire à l’ensemble de la population. À l’international, certain.es voudraient que cela se concrétise en une forme d’impôt négatif, où les gouvernements donneraient de l’argent à tout ménage possédant un revenu annuel au-dessous d’un certain seuil. La plupart des partisan.es du RMG militent cependant pour une allocation universelle, c’est-à-dire un chèque annuel du même montant pour chaque personne (les plus fortuné.es voyant cette somme se dissiper au moment de payer leurs impôts, contrairement aux plus pauvres).
Le premier ministre Couillard a mandaté l’hiver dernier son ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, d’étudier la faisabilité de l’instauration du RMG au Québec. Il faut dire que monsieur Blais, ancien doyen de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, était lui-même un chercheur et fervent partisan du RMG avant sa carrière politique. Mais pourquoi ce regain d’intérêt autour du revenu minimum garanti? Au sein des pays les plus riches de la planète, les gouvernements (de gauche comme de droite) constatent, d’une part, qu’un nombre croissant de secteurs de leur économie requièrent de moins en moins de main-d’oeuvre, du fait de l’automatisation de la production (robots et algorithmes). D’autre part, le marché de l’emploi dans les secteurs des services et de la culture offre de moins en moins d’emplois permanents à temps plein et de qualité. Dans un tel contexte, offrir un RMG permettrait de contribuer à la restructuration du marché de l’emploi grâce à de nouveaux leviers sur le taux de chômage, et de relancer la consommation pour faire rouler l’économie⁷. Par ailleurs, la simplification radicale des programmes de soutien au revenu – un des buts avoués de l’étude demandée à Blais – permettrait par la suite au gouvernement de se passer des services d’une quantité importante de fonctionnaires et d’ainsi diminuer les coûts de fonctionnement de l’État.
Le RMG peut sembler être une nouvelle politique intéressante (assurance d’un filet social minimal pour tous et toutes, émancipation relative par rapport au marché du travail, réduction de la bureaucratie étatique), mais on se doute bien que Philippe Couillard n’envisage pas de le mettre en place pour nous faire plaisir. L’instauration de cette nouvelle façon de faire pénaliserait sans doute certains programmes existants, dont possiblement l’AFE, en plus de normaliser l’existence d’emplois à temps partiel, à faible salaire ou atypiques. Il importe donc que les étudiant.es soient très vigilant.es au sujet du RMG dans les prochains mois: les sommes allouées aux programmes de soutien au revenu, dont l’AFE, sont déjà nettement insuffisantes, et ce serait bien le comble de voir en plus ces programmes être diminués ou restructurés à nos dépens… sous prétexte de parfaire le filet social!
Avec le revenu minimum garanti, l’État se distancierait de son approche paternaliste habituelle en traitant chaque personne sensiblement de la même manière, mais ce faisant, il renoncerait aussi d’une certaine façon à la mission sociale-démocrate de support aux plus vulnérables. Bien sûr, si la mise en place du RMG donnait lieu à une mobilisation sociale importante et débouchait sur un RMG élevé et sans coupures des programmes de soutien au revenu existants, il s’agirait d’une grande victoire. Malheureusement, du fait de la faiblesse actuelle des mouvements sociaux québécois, si le gouvernement Couillard va de l’avant avec ce projet, le scénario le plus probable est un RMG remplaçant seulement certains programmes de soutien, légèrement plus généreux et implanté à coût nul grâce aux coupures de personnel à prévoir. Cela placerait le PLQ en meilleure posture pour se faire pardonner ses coupures de début de mandat et ainsi remporter les élections provinciales de 2018.
Ce débat qui vient entre AFE et RMG revient à un faux choix qu’on peut poser ainsi: alors, quatre trente sous ou une piastre dans vos poches? On peut faire bien mieux comme société: un salaire pour le travail étudiant – si certain.es veulent le fixer à 15$ de l’heure, pourquoi pas! Mais on a beaucoup de pain sur la planche pour y arriver, car la revendication du salariat étudiant est éminemment subversive y compris dans le milieu de l’éducation⁸. Elle remet en question quelles activités devraient être valorisées dans notre société, et ce, en fonction d’une vision de la société comme étant traversée par des conflits fondamentaux plutôt que selon la fiction libérale d’un éventuel authentique « droit à l’éducation »… qui ne peut être ici et maintenant qu’un faux gain symbolique que l’État réinterprèterait constamment en fonction de ses propres intérêts⁹. De plus, en réduisant drastiquement la nécessité d’un emploi à temps partiel durant les études, l’instauration du salariat étudiant constituerait un exceptionnel test pour l’essentiel projet de réduction du temps de travail sans perte de salaire qui, une fois prouvée comme nettement désirable (en douterait-on!), pourrait ensuite être revendiquée avec beaucoup plus d’aplomb par l’ensemble des travailleuses et des travailleurs. En se mobilisant à long terme pour cette cause et avec un peu de chance, les étudiant.es pourront peut-être vraiment profiter à l’avenir de leurs vacances pour faire le plein d’énergie, comme la plupart des autres travailleuses et travailleurs à temps plein, afin de mieux s’investir le reste de l’année dans leurs études et, souhaitons-le, dans tout le travail requis pour changer le monde.
François Bélanger
Félix Dumas-Lavoie
Cet article a été publié dans le numéro de cet automne du CUTE Magazine.
- Pour des données exactes sur les sommes accordées pour l’année la plus récente disponible, voir la section «Faits saillants» de ce document: http://goo.gl/N1O1LW
- L’exercice du remboursement de la dette d’étude rend flagrante cette absence de sollicitude à l’égard des étudiant.es. L’État qui semblait prompt à une aide bienveillante pendant les études se transforme avant longtemps en croupier qui n’a qu’une ambition: ramasser le plus gros des économies étudiantes pour rentabiliser l’exercice.
- Pour plus de détails: http://goo.gl/NXlRi5
- Pour en savoir plus sur le problème patriarcal que constitue ce type de conditions dans l’AFE, voir cet article: http://dissident.es/?p=422
- Lesbiennes, gais, bisexuel.le.s, trans, queer, intersexes, asexuel.le.s et autres.
- Sur la question de la valeur du travail étudiant, voir cet article écrit par le CUTE du cégep Marie-Victorin le printemps dernier: http://dissident.es/?p=369
- Sur l’enthousiasme du patronat de la Silicon Valley au sujet du RMG, voir cet article (en anglais): http://gu.com/p/4yaye
- C’est même un tabou au sein de la gauche étudiante. Un grand nombre de militant.es d’expérience savent ainsi que l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) a un mandat de longue date en faveur du salariat étudiant, mais balaient cette option sous le tapis du fait de son statut minoritaire et par réalisme lâche.
- Et l’exception n’a pas à faire la règle: les étudiant.es connaissant des difficultés scolaires quelconques et dont la production étudiante serait alors jugée insuffisante pourraient en contre-partie bénéficier de programmes de support au revenu temporaires pour retenter leur chance, ou transitionner vers un autre programme ou le marché du travail, de la même façon que les travailleurs et travailleuses peuvent bénéficier de congés de maladie ou de chômage lorsqu’ils et elles vivent des difficultés. Des programmes analogues existent aussi pour les personnes en situation de handicap (ex. contrats d’intégration au travail).