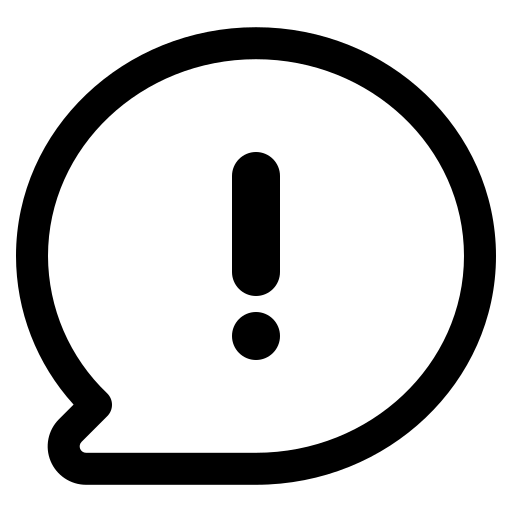L’hiver dernier, le Syndicat étudiant du cégep Marie-Victorin (SECMV) a été la première association étudiante à adopter un mandat de campagne sur le travail étudiant. Depuis lors, nous avons créé un comité local spécial sur la question, le Comité unitaire sur le travail étudiant de Marie-Victorin (CUTE-MV), et pensé aux détails des diverses revendications de cette campagne. En parlant avec les étudiant-E-s du cégep et avec nos camarades, nos craintes quant à l’obscurité relative d’une revendication ont été confirmées; c’est celle pour “la valorisation et l’utilisation concrète de la production étudiante par la mise en place d’un programme à cet effet au collégial comme au niveau universitaire.” Il nous semblait donc important de clarifier publiquement la signification de cette demande afin de commencer à la populariser dans les mois et années à venir, étant donné qu’elle nous paraît essentielle pour toute lutte sérieuse sur la question du travail en tant que relation sociale à redéfinir.
Le syndicalisme étudiant québécois est né en affirmant sa propre conception de l’étudiant comme étant un «jeune travailleur intellectuel», comme dans la Charte de Grenoble. Cette conception et la Charte, vieille de 70 ans, ne colle cependant plus à la réalité contemporaine de l’éducation d’ici. Premièrement, il est de plus en plus erroné de considérer les étudiants comme tou-tes jeunes. Beaucoup de gens maintenant font un retour aux études durant leur vie, généralement dans une logique de formation continue. Cela est particulièrement vrai dans les programmes techniques de niveau collégial, passage requis pour beaucoup de travailleur-euses précaires qui veulent changer de domaine d’emploi après une autre mutation dans le marché de l’emploi de la soi-disante “économie du savoir”. Pourtant, le mythe de l’étudiant-e comme «jeune» persiste dans le mouvement étudiant et dans la société, ce qui facilite la tâche à l’État et aux patrons pour infantiliser toute cette catégorie sociale, à nos dépens.
En outre, l’étude est un travail utile pour lui-même mais aussi pour la collectivité, tant au niveau économique que culturel. Ce travail, c’est bien connu, n’est cependant pas payé: l’État offre tout simplement une maigre subsistance aux étudiant-es les plus pauvres. Cela reproduit constamment l’idée que l’éducation est improductive, à la manière d’autres activités telles que le travail domestique, historiquement dévalué au détriment des femmes. Enfin, les droits et devoirs intellectuels des étudiants sont mis de côté dans une société où l’État ne cherche que de futur-es contribuables dociles, où l’intelligentsia est soumise à des idéologies dépassées et où le mouvement étudiant n’a jamais abordé sérieusement la pédagogie, si ce n’est pour se révolter symboliquement contre la « marchandisation de l’éducation » de temps en temps.
La stratégie générale d’obtention du plus bas prix possible pour l’éducation (frais de scolarité, aide financière aux études) du mouvement étudiant est une posture clientéliste, ne se concentrant globalement que sur quelques droits et sur aucun devoir social des étudiant-es. Rien ne subsiste alors du positif de la charte de Grenoble sur laquelle on se base pourtant, ce qui ne nous aide pas à passer publiquement pour autre chose que des enfants improductifs un peu grincheux et prompts à des chocs violents, une fois les 5 à 10 ans, et qui nous aide encore moins à travailler pour un rapport non marchand à l’éducation. Nous croyons qu’une bonne façon de changer les choses est de marteler que les études sont un emploi, et que les étudiantes et étudiants méritent de bonnes conditions d’études et le pouvoir d’influencer ces conditions. Voilà le motif central des différentes demandes de notre campagne sur le travail étudiant, mais elles n’ont un sens que si l’on convainc la population étudiante et la société en général que le travail étudiant a de la valeur et doit en acquérir davantage.
Cette stratégie est d’autant plus urgente que le calcul “qui s’instruit s’enrichit” ne tient plus la route: le mouvement étudiant du Québec a été incapable de contrer l’explosion générale des coûts d’études au cours des dernières années, décrétée par des gouvernements ayant remarqué sordidement qu’une éducation en plus forte demande pouvait être vendue plus chère. Il est inacceptable de vouloir nous faire croire que la précarité étudiante n’est qu’un mal nécessaire à court terme, quel que soit notre âge; la valeur du travail étudiant est réelle, comme celle de la formation en entreprises et de nombreuses activités culturelles qui sont, elles, payées, et à juste titre.
S’il est clair que les stages inclus dans un programme d’études devraient être rémunérés, pourquoi l’activité associée à d’autres méthodes d’apprentissage de l’école ne l’est-elle pas? Certaines associations étudiantes ont déjà plaidé en faveur de l’introduction d’un salariat étudiant, cependant le mouvement étudiant ne défend l’éducation que comme un service public, idéalement gratuit. Mais à la différence des services publics en général, être éduqué implique un aspect de travail proactif, dont les équivalents sont généralement payés sur le marché du travail. Cela devrait maintenant être le tour des étudiant-es de l’être, en particulier lorsque l’appartenance syndicale est revendiquée. L’ASSÉ, pourtant au courant des positions du SECMV, a volontairement choisi lors de son dernier congrès de se limiter à une approche clientéliste en retirant de sa campagne la perspective du travail étudiant, ce qui n’a rien de surprenant et ne constitue qu’une nouvelle raison pour se dissocier de cette organisation sclérosée et moribonde.
Nous aurons à examiner prochainement les différentes façons dont les tâches liées aux études (présence en classe, discussions en classe, lectures, travaux, présentations, évaluations, contributions à la recherche et la création, mentorat, publications scientifiques…) devraient être récompensées et selon quels critères (heures impliquées, heures actives, notes, aide d’autres étudiant-es, popularité des productions…). Car bien que la piste de la rémunération soit celle qui nous semble la plus équitable en général, elle peut ne pas être la plus appropriée en toutes circonstances, et d’autres méthodes peuvent alors être considérées comme des subventions spécifiques, l’accès facilité aux formations contingentées, des certifications spéciales (mention d’honneur au diplôme par exemple), des mentorats et des cours individuels, l’introduction à des réseaux socioprofessionnels, des prix, etc. De telles reconnaissances pourraient notamment cibler les groupes de personnes historiquement marginalisées dans le système d’éducation dite « supérieure » du Québec, telles que les personnes racisées, handicapées, non hétérosexuelles ou non cisgenrées.
Cette approche de l’évaluation, salariée ou non, remettrait en cause la séparation relativement malsaine entre les programmes de cycles supérieurs, de maîtrise et de doctorat, et les autres programmes. Nous croyons en effet qu’une grande partie du travail étudiant pourrait progressivement être assimilée à des travaux de recherche, un peu à l’image des Expo-sciences. Comme celles-ci, le travail étudiant pourrait également être conçu pour contribuer aux travaux de recherche existants, ou à diverses responsabilités académiques actuellement négligées, par exemple la vulgarisation de la science ou la participation aux débats politiques. Concrètement, cela pourrait revenir carrément à l’extension de la catégorie d’emploi des « employé-es étudiant-es » et à y intégrer, à certains égards, l’ensemble des étudiant-es.
Inutile de dire que les premières personnes qui bénéficieraient d’une telle réforme seraient les victimes d’oppression systémique, réforme qui contribuerait à leur ouvrir durablement des portes. Par exemple, même si elles ont fait des pas importants dans la bonne direction, les femmes n’ont pas encore l’égalité d’accès à des responsabilités de recherche et, trop souvent, souffrent de situations de harcèlement sexuel. Le pouvoir supérieur d’un groupe de travailleuses et travailleurs par rapport aux groupes de bénéficiaires étudiant-es d’aujourd’hui devrait donner des armes supplémentaires pour combattre ce fléau. Plus généralement, les tâches socialement utiles supplémentaires confiées aux étudiant-es suite à une telle réforme donneraient encore plus d’impact à leurs moyens de pression, en plus de permettre d’en créer de nouveaux.
Historiquement, ce sont les maîtres qui contrôlent les tenants et les aboutissants du travail de leurs élèves. Mais si l’on considère l’avenir de ces personnes en tant que travailleur-euses et non pas comme assisté-es, la question de leur pouvoir sur leur production pourra s’affirmer plus clairement que jamais. Dans de telles circonstances, il serait inconcevable que la lutte pour la réforme revendiquée ici ne nécessite pas du même souffle une part au moins significative de cogestion du travail scolaire, avec les enseignant-es et les employé-es de soutien. L’obtention de tels pouvoirs pourraient enfin permettre aux étudiant-es de déterminer au moins certains des objectifs et des façons d’étudier, voire tous.
L’impact d’une telle réforme dépasserait de loin la sphère académique. Les grand-es gagnant-es seraient bien sûr les étudiant-es qui, avec de meilleures conditions de travail et le pouvoir sur celles-ci, pourraient mieux répondre à leurs responsabilités sociales de recherche de la vérité et agir en conséquence. Les personnes précaires dans leur ensemble en bénéficieraient également, dans la mesure où leurs conditions d’étude et de travail (moins d’étudiant-es avec des McJobs -> baisse du chômage et meilleures conditions d’emploi) en seraient améliorées. Enfin, le grand public bénéficierait d’une augmentation majeure des travaux de recherche, et ainsi avoir accès à une production intellectuelle et culturelle augmentée. Les plus grand-es perdants-es seraient la bourgeoisie dont la stratégie repose en partie sur les McJobs, et les partisan-es de la famille patriarcale puisque les jeunes étudiant-es pourraient maintenant s’en émanciper plus facilement.
Pour toutes ces raisons, nous croyons que toute personne reconnaissant que l’éducation est un travail doit s’organiser pour réclamer à la fois le salaire étudiant et la justification sociale de ce salaire: la valorisation et l’utilisation concrète des productions étudiantes, par l’intermédiaire des programmes concrets à cette fin. Nous invitons les étudiantes et étudiants à organiser maintenant des comités de travail sur leurs campus pour pousser les réflexions sur ces sujets en perspective d’une campagne forte à l’automne pour l’obtention d’une première série des gains concrets : le plein salaire à toute étudiante et tout étudiant en situation de stage et des expériences préliminaires de valorisation et d’usage public réel de nos autres formes de travail.
CUTE-MV (comité unitaire sur le travail étudiant du cégep Marie-Victorin)