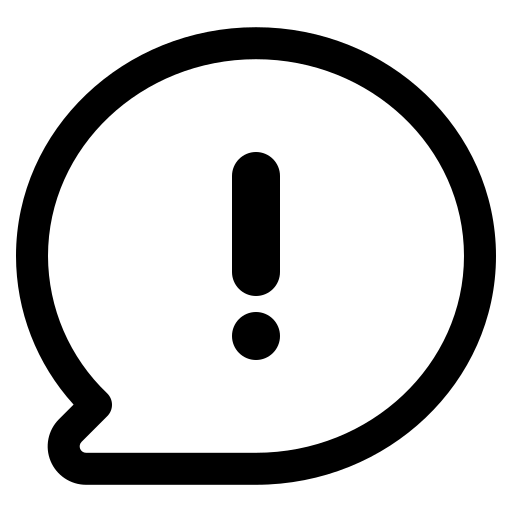Les stages non rémunérés constituent un passage obligé dans bon nombre de programmes techniques et professionnels, une épreuve largement appréhendée par les étudiantes et étudiants qui devront un jour ou l’autre passer par là. Si on les présente comme une bonne occasion de faire son entrée sur le marché du travail puisque les offres d’emplois exigent désormais systématiquement des expériences préalables, les entreprises et organismes en question profitent tout de même directement du travail des stagiaires, qui s’en trouvent rudement précarisé-es des semaines, voire des mois durant.
Le calcul qu’on évite
4 325 $. C’est ce qu’aurait gagné Djilali s’il avait reçu le salaire minimum pour les quelque 410 heures de stage qu’il devait compléter au cours de la dernière session de sa technique en documentation. Au lieu de cela, il s’est lourdement endetté: «J’ai essayé du mieux que j’ai pu d’amasser des économies pour passer l’hiver, mais c’est plus facile à dire qu’à faire quand on est aux études à temps plein.» Même s’il avait au départ l’intention de travailler les soirs et les fins de semaine dans son emploi qu’il a conservé à temps partiel depuis son retour aux études, les stages se sont finalement révélés trop prenants: «avec les journaux de bord à rendre tous les vendredis soirs et le rapport final à remettre, impossible d’avoir un autre job pendant»
Le cas de Djlilali n’est bien sûr pas isolé. Un scénario classique, banal même, pour ses collègues et pour la plupart des stagiaires des programmes techniques et professionnels. Si les instituts statistiques provinciaux et fédéraux ne compilent aucun chiffre officiel sur le sujet, on estimequ’entre 100 000 et 300 000 stages sans rémunération ont cours chaque année au Canada, une quantité énorme de travail gratuit pour les entreprises et organismes au pays. Selon Andrew Langille, avocat torontois en droit du travail, «les collèges et les universités offrent de plus en plus de stages non rémunérés dans le cadre de leurs programmes d’études depuis la fin des années 1990.» Ce serait toutefois depuis la crise économique de 2008 que le nombre de stages bénévoles aurait connu la plus forte croissance, avance Sean Geobey, auteur du rapport The Young and the Jobless et chercheur associé au Centre canadien de politiques alternatives. L’Association canadienne des spécialistes en emploi et des employeursremarque quant à elle «un bond important du nombre de stages non rémunérés affichés en des endroits où ils étaient habituellement rémunérés.»
La dépendance qui tourmente
Béatrice, étudiante en animation et recherche culturelles, fait partie du nombre. Durant ses deux dernières sessions, elle a dû accomplir pas moins de six mois de stage à temps plein dans un musée, sans recevoir le moindre sou: «il a fallu retourner vivre chez mon père, sans quoi je n’y serais jamais arrivée,» dit-elle. Situation similaire au baccalauréat en travail social, où le stage obligatoire est de cinq jours par semaine durant la cinquième session et de quatre jours par semaine durant la sixième. Catalina, future TS et mère de deux enfants, redoute ce moment à venir: «le stage me placera dans une situation de dépendance extrême vis-à-vis du père de mes enfants, avec qui je n’habite plus depuis un bon moment, et avec mes propres parents qui sont loin d’être riches eux-mêmes.» Idem pour le baccalauréat en enseignement. Dans un texte sur les pressions masculinisantes et le processus d’exclusion des femmes de sa profession, Jeanne rapporte que «l’Université nous lance “oubliez ça le travail ou les enfants pendant le stage 4!” […] elle dit aux mères monoparentales d’arrêter d’être pauvres et d’envoyer les petits pendant quatre mois chez leur père absent.»
Pas de salaire, pas de protection
Mais la future enseignante signale aussi une autre dimension du problème, qui accompagne la précarisation financière: l’absence de protection. Selon elle, l’université «ignore les situations de racisme, de sexisme et de violence psychologique en stage en invoquant la violence inhérente au travail». Les stages crédités et évalués dans le cadre d’un programme scolaire ne sont en fait pas même couverts par les normes du travail qui, disons-le, sont déjà loin d’être suffisantes pour protéger la dignité et l’intégrité des travailleuses et travailleurs. L’absence de protection vulnérabilise dramatiquement les stagiaires. Des témoignages en provenance de l’Outaouais soulignaient par exemple il y a quelques années que les étudiantes noires échouaient systématiquement le stage de sciences infirmières et qu’elles n’avaient aucun recours ensuite. D’ailleurs, on s’en doute, les catégories sociales les plus représentées dans les stages non rémunérés sont également les plus vulnérables: les jeunes, les personnes immigrantes, les femmes et les employé-es en transition de carrière.
Faudrait pas se croire en vacances non plus!
Si on ne semble pas considérer que les stagiaires méritent rétribution, puisqu’on les paie «en notes et crédits» (dit-on), les stages bénévoles n’en sont pas moins exigeants. On s’attend à un certain rendement de leur part, autant du côté de leurs enseignant-es que de celui des organisations qui les accueillent. Les étudiant-es au doctorat en psychologie, par exemple, ont un internat où elles et ils doivent dispenser des services thérapeutiques aux patient-es. Dans une récente vidéode la Fédération interuniversitaire des doctorant(e)s en psychologie, une doctorante expose les conditions de l’internat obligatoire à la fin des études: aucune rémunération pour les 1 600 heures de travail à temps plein, un travail à la hauteur d’environ 80% de la charge d’un-e professionnel-le. «Après un an à travailler gratuitement dans les réseaux publics, en plus de payer des frais de scolarité, on peut comprendre les jeunes psychologues de se tourner vers le privé…» dit-elle pour expliquer que le gouvernement participe ainsi au maintien de la pénurie artificielle de psychologues dans le réseau de la santé.
Autre exemple. Durant les quatre années de leur formation, les futur-es enseignant-es sont appelé-es à prendre progressivement en charge une classe, c’est-à-dire à accomplir toutes les tâches liées à la profession enseignante. En quatrième année, les stagiaires accomplissent soixante-deux jours de stage dont la seule modalité stipule «une prise en charge maximale de la tâche d’enseignement». Les règles concernant la suppléance en cours de stage sont claires: «les étudiant-es inscrit-es aux programmes de formation à l’enseignement ne sont pas autorisé-es à faire de la suppléance au cours de la période prévue pour la réalisation de leur stage». On explique cette position, entérinée par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et les commissions scolaires, par la nécessité de déterminer qui de la commission scolaire ou de l’université est responsable des actes posés par l’étudiant-e. Cependant, les actes de l’enseignant-e associé-e ne sont pas régis aussi clairement, et nombreux sont les cas de stagiaires laissé-es à elles-mêmes pendant toute la durée de leur stage. À l’université, on explique que la profession est difficile et que c’est à la dure qu’on apprend aux étudiant-es le métier.
Dans un contexte où le chômage est déjà élevé chez les jeunes, les stages non rémunérés, durant et après les études, viennent aggraver la situation. Dans certainssecteurs, notamment ceux de la culture et des communications, des postes sont carrément occupés en permanence par un roulement de stagiaires bénévoles. Et on ne parle pas forcément de petites boîtes qui n’en ont pas les moyens… et même quand c’est le cas, ce n’est pas acceptable pour autant!
N’en avez-vous pas assez?
Aux États-Unis et au Canada, de plus en plus de plaintes sont formulées, de plus en plus de batailles juridiques et politiques sont entreprises pour l’abolition des stages non rémunérés par voie légale. Pour l’instant le combat se limite aux stages après études, puisqu’on justifie encore que les crédits reçus dans le cadre d’une formation font figure de compensation. Nous ne l’entendons pas ainsi.
Au Québec, depuis août 2014, des associations étudiantes en éducation s’organisent sous la bannière de la CRAIES, la Campagne de Revendication et d’Actions Interuniversitaires des Étudiant-es en Éducation en Stage, qui a pour objectif d’obtenir une compensation financière du gouvernement pour les étudiant-es lors de leurs stages de prise en charge; le montant de la compensation financière est chiffré à 330$ par semaine pour les trois mois du quatrième stage. Près de deux ans après le début de la campagne, les associations participantes ne se sont toujours pas arrêtées sur un argumentaire commun. Elles partagent par contre comme revendication une compensation financière et non pas la reconnaissance d’un travail par l’attribution d’un salaire. La nuance est importante et impose une distance entre le personnel enseignant syndiqué et les stagiaires. De plus, la compensation financière ne serait versée que lors du quatrième stage, bien que les stagiaires en enseignement soient monopolisé-es pendant vingt-cinq jours dès le premier stage.
Les doctorantes et doctorants en psychologie ont pour leur part décidé de jouer le tout pour le tout: faire la grève de l’internat dès l’automne prochain et toute l’année durant, pour réclamer un salaire à la hauteur de celui donné lors de l’internat en médecine. Il s’agit d’un cas rare dans la «Belle province» d’appel à la grève des stages, et cette audace est tout à leur honneur, puisqu’elle leur donne d’autant plus de chances de gagner.
Nous aussi on en a assez!
Il est temps de leur emboîter le pas et de s’organiser avec l’ensemble des stagiaires, dans tous les domaines et à tous les niveaux d’études, afin de réclamer le salaire qui nous est dû. Cette lutte a le potentiel de tenir une place centrale dans un large mouvement de reconnaissance et de valorisation du travail étudiant. L’exécution d’un travail contre une ligne sur un CV n’est pas un échange de bons procédés, et la formation en emploi n’est d’aucune façon une récompense. La misère étudiante est celle qui nous convainc qu’on doit payer pour être formée; elle est celle qui nous fait croire que nous ne produisons rien lorsque nous apprenons; elle est celle qui nous habitue à la précarité qui n’en finit plus sur le marché du travail. C’est en refusant l’exploitation dès les études qu’on se prépare le mieux à améliorer concrètement nos situations pour la suite. Et bien entendu, on ne s’arrêtera pas là!
Comité unitaire sur le travail étudiant du cégep Marie-Victorin (CUTE-MV)
Valérie Simard, étudiante en adaptation scolaire, UQAM
Etienne Simard, étudiant en techniques de la documentation, Collège de Maisonneuve